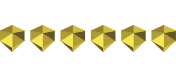Tout est dans le titre
par LeBeauSon Juin 2020
PERCEPTION D’ENSEMBLE
Après un démarrage un peu laborieux en France alors que la marque est distribuée dans 26 pays, Grandinote a enfin trouvé la place qu’elle mérite, pour certains au sommet de la pyramide.
Synthèse du savoir-faire de Max (the boss), l’intégré Supremo rentre dans le petit club très fermé des OVNI qui planent au-dessus de la pyramide.
… réussissant une alliance parfaite entre définition des teintes ou matières et déploiement harmonique, le Supremo imbrique naturellement l’immanence de la force intérieure d’un texte d’une douloureuse intensité dans le timbre serein, sombre, comme finement corrodé et subtilement articulé, tout en sachant parfaitement respecter la distance à l’intimité affective de l’artiste…
… le spectacle orchestré par le Supremo égale ou dépasse ce que peut donner le cinéma 3D de James Cameron à son apogée…
… le Supremo campe les intervenants sur une scène d’une ponctualité telle qu’on pourrait en pointer les emplacements sur le sol - qui plus est en détectant avec une totale certitude les dimensions de la salle d’origine…
Un moment aussi saisissant d’autorité, de concentration que de poésie !
Côté dynamique, vitalité et swing ? Ben : c’est un festival…
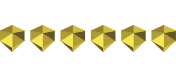

Grandinote
Grandinote est une marque italienne (Lombardie plus précisément) dont le nom résonne de plus en plus fort sur la scène internationale. Si les premières productions de la marque (début des années 2000) étaient des amplificateurs, le catalogue offre désormais une panoplie complète : source numérique, préampli-phono, enceintes acoustiques et même supports pour les électroniques. Ne manquent que les câbles pour faire du mono marque.
De notre côté, nous n’avons pas attendu que la célébrité s’installe en France pour apprécier (si ce n’est adorer) les productions électroniques de Max et nous manipulons depuis longtemps Volta, Shinai, Essenza et consorts et en avons même connu quelques évolutions.
Shinai et Essenza représentaient déjà des musts dans la catégorie des amplificateurs intégrés, surtout rapportés à leur prix (oui, je sais, tout est relatif), mais il a fallu que ce diable de Max propose le Supremo pour que les certitudes s’écroulent.
Des fois c’est agaçant !
Comme vous savez que je ne suis pas féru des descriptions techniques, je vais faire court : la base de tous les amplis de la gamme, c’est le Shinai. Un intégré double-mono (une alimentation par canal) d’un schéma novateur puisque les transistors sont utilisés comme des tubes, impédance interne haute, haute tension, tout ça tout ça, et donc reliés à des transformateurs de sortie pour une exploitation sous impédance standard. En vérité, l’impédance de sortie est très basse pour un meilleur contrôle du grave.
Un schéma unique.
Et d’ailleurs assez difficile à décliner. Ainsi, les appareils plus puissants de la marque sont identiques mais bridgés (un appareil stéréo devient mono et donc il en faut deux).
L’Essenza, c’est exactement la même constitution que le Shinai mais avec des transformateurs de sortie de qualité supérieure dit Magnetosolid-VHP et évidemment, ça s’entend !
Le Supremo, eh bien c’est pareil sauf que c’est pas la même chose…
Il semble que la partie amplification soit identique à l’Essenza, mais le ou les étages d’entrée sont plus élaborés, reprenant le travail développé pour le préamplificateur vedette qui répond au joli nom de Genesi.
Le Supremo souffre d’ailleurs du même handicap que le Genesi : il n’est pourvu que d’entrée symétriques (4), même si je crois que deux des entrées peuvent être utilisées en asymétrique, via le menu (j’ai complètement oublié de vérifier) mais toujours sur prises XLR, donc via un adaptateur. Une des entrées peut être programmée en sortie.
Alors que nous nous sommes fait une loi de ne pas parler technique, je suis exaspéré de tomber dans le panneau à chaque fois !
Allez, continuons : le Supremo est basé sur un schéma entièrement symétrique et développe 37 W en pure Classe A. Prévoyez une bonne aération pour l’appareil. Il est conçu sans la moindre contre-réaction et sans condensateur de liaison inter-étage…
… Votre revendeur vous expliquera.
Moi je n’ai pas que ça à faire, j’ai confinement.
Le Supremo est un intégré de bonne taille sans être ridiculement gigantesque non plus ; sa façade étroite est compensée par une profondeur peu commune : 318 x 196 x 473. C’est la disposition particulière des deux transistors et deux transformateurs par canal qui imposent ce format.
Qui peut être trompeur car le bébé pèse quand même 40 kgs !
Or, ce n’est pas le châssis qui fait le poids, puisqu’il s’agit, comme sur Shinai et Essenza (et pour cause : c’est le même) de deux tranches pas spécialement épaisses de profilé noir granuleux reliées par des plaques supérieure et inférieure très ajourées et polies. La rigidité est en revanche assurée par deux énormes radiateurs internes qui traversent l’appareil de l’avant vers l’arrière. 5 boutons en façade encadrent l’afficheur central, un gros pour mettre sous tension et deux fois trois sur les côtés pour sélectionner les entrées, accéder au menu et bien sûr régler le niveau.
Sélection d’entrées et niveau sont accessibles par la télécommande, joli petit pavé d’aluminium de faible épaisseur.
Je vais éviter tout commentaire sur l’esthétique du petit monstre : il n’a clairement pas été confié à Pininfarina, mais à l’arrivée l’objet, dans son look de matériel militaire des années 50, a une vraie bouille. Et pour être honnête, j’aime assez ce côté décalé.
Ah oui : la (grandi) note ? 24 000 €. Vous me croirez si je vous dis que c’est cadeau ?
Essais menés avec sources Grandinote (Volta et double Celio (derrière une EAT Fortissimo, bras Moerch et cellule Van den Hul The Crimson), Eera, TAD, Chord, Accuphase, Aurorasound…
Enceintes ? Une floppée : TAD E1 TX, ppfff Ada et Ava, Mulidine Harmonie V3 et ++, Living Voice IBX, Wilson Benesch et Wilson Audio (vraiment aucun lien de parenté ou de philosophie, mais alors vraiment aucun).
Câbles : Absolue Créations Tim-Ref à Tim-Signature, Vent des Nuls (depuis le temps que ça me démangeait), Alef, Wing, Nodal, Neodio, Legato.

RICHESSE DES TIMBRES ET ÉQUILIBRE TONAL
Allez, c’est parti : premier chapitre :
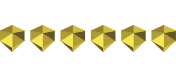
Voilà…
… Euh, c’est un peu court ?
Faudrait savoir…
Bon…
Côté timbres, on n’a jamais entendu une telle alliance entre définition des teintes ou matières et déploiement harmonique sur un intégré à transistors, bien que, soyons honnête, sur ce point il ne soit pas forcément le seul à revendiquer une louable richesse.
Alors pourquoi jamais entendu ? Parce la récolte harmonique du Supremo dépasse la moisson pour tout révéler des glumiflores, depuis les racines sous une grasse terre fertile jusqu’aux chaume et ramification des épillets sessiles gorgés de sève. Nous connaissons certes un intégré qui fait jeu égal avec un soupçon de souplesse en plus, mais il est à tubes et c’est notre actuel référent. Et il est un peu plus coûteux. Et il n’a pas de télécommande.
Donc côté noblesse et droiture, le Supremo est à l’heure actuelle notre « second best », mais avec d’autres atouts…
La saveur des arômes colorimétriques sur les Quatuors de Górecki (et Genesi 1 : Elementi pour trio : œuvre de référence) par le Tippett Quartet signe un véritable renouveau du printemps !
Bouleversements croisés de propositions tonales et atonales, la musique de chambre de Górecki passe par des épanouissements de gouaches au-delà de l’arc en ciel et ignore le gris ! Le propos est particulièrement bien édifié et nuancé dans les virages de contrastes par les anglais du Tippett, qui donnent du cœur et du corps à ces œuvres en refusant l’emphase des créateurs des deux quatuors : le Kronos… Jubilatoire perception des scintillements des cordes et trépidations des suaves textures du bois, la probité de reproduction par le Supremo est telle qu’elle devient incarnation.
La voix de Lhasa (de Sela) touche au sublime par l’alliance du Supremo et des Ava de ppfff, dans l’album « The Living Road », deuxième disque de l’américano-mexicaine (et canadienne) disparue bien trop tôt, ouvrage somptueusement noir où l’auteure-compositrice conte des épisodes de vie déchirants en déconcertante liberté de mélodies avortées, de thèmes déstructurés, laissant quelques espaces fertiles aux invités (Ibrahim Maalouf inspiré (c’est dire !) sur « Anywhere on this Road ») ; Lhasa imposant la solennité d’une voix grave aux nuances de bronze, rauque, immanente, habitée d’une sourde tristesse, oblige à réfléchir à la vacuité artistique standard de notre époque, et surtout au fait que de si nombreuses chanteuses aux moyens vocaux incontestablement solides ne comprennent rien à l’expression… Je sais, ma complainte est récurrente.
C’est intéressant de se poser la question de la nécessité d’un objet superlatif tel le Supremo pour vivre la beauté des larmes perlant d’une âme meurtrie. Peut-être que la réponse est non… Mais ressentir la présence charnelle, le noyau d’humanité que l’Ange brisé imprime à chaque note, et mieux encore chaque silence, chaque accentuation, transforme une touchante chanson eurythmique en un cœur de pureté séraphique.
Ainsi « My Name » évolue en monument de grâce sur lequel plus que jamais il est difficile de retenir les sanglots : le Supremo imbrique naturellement l’émanation de la force intérieure d’un texte d’une douloureuse intensité dans le timbre serein, sombre comme finement corrodé et subtilement articulé, tout en sachant parfaitement respecter la distance à l’intimité affective que Lhasa dose si pudiquement.
Faites l’expérience et vous comprendrez mieux combien la haute-fidélité se fourvoie généralement.
Personne n’a besoin de moi pour connaître une chanteuse de l’envergure de Lhasa, mais d’un Supremo, d’un Kondo Overture et de quelques autres guides pour fusionner le cérébral et l’émotionnel qu’une telle artiste représente au plus profond de nous ? Si !
C’est vrai quoi, il y en a marre de lire du n’importe quoi sur des appareils à pas de prix qui sont contents de faire joli. L’émotion, l’émotion, tout le monde n’a que ce mot à la bouche alors qu’on finit par se demander qui est prêt à en accepter ses sources foncières.
Allez, pour finir avec la rubrique timbres (ceci étant avec Lhasa, j’ai déjà avancé de deux crans dans l’ordre des chapitres et directement tapé dans « l’Expressivité »), je vais parler d’une autre femme, moins connue, qui a dû se battre pour trouver sa place dans un monde alors très conservateur : la compositrice (et hautboïste (et pianiste ?)) Ruth Gipps (1921-1999) a légué un large héritage musical incluant 5 symphonies dont elle était très fière. A juste titre.
Est paru chez Chandos il y a environ deux ans un disque - hautement recommandé - regroupant les Symphonies 2 & 4 et deux courtes œuvres complémentaires, interprétées par le BBC National Orchestra of Wales sous la direction de Rumon Gamba.
La Symphonie n° 4 Op 61 est singulièrement digne d’intérêt, parce que si on devine dans les longues vagues paresseuses l’influence de Ralph Vaughan Williams ou Arthur Bliss, on discerne dans les enluminures éthérées, sublimement agencées, des influences clairement debussiennes (dans l’Adagio c’est indubitable) !
Outre que la compositrice britannique a de tout temps rejeté toute forme de « modernité » sérielle ou autres, elle franchit un niveau d’éminence onirique, infusée par la cascade spectrale d’extensions filigranées, arachnéennes, où bois et cuivres forment des échos mutuels d’un langage supérieur, et les pupitres de cordes respirent de couleurs plus transcendantales que bucoliques… Quelques moments d’excitation parfois - de joyeux comme une musique de dessin animé à paroxystiques (fin du Moderato) -, soit, mais dans l’ensemble elle ouvre un univers majestueux et majestueusement gravé par le Supremo qui nous promène nonchalamment dans ces courbes amples, révélant chaque texture harmonique, la substance des matériaux, la chair et le sang des musiciens derrières les instruments. Le solo de cor du premier mouvement comme celui du violon qui termine le deuxième, la frêle agitation d’une élégance inouïe - et cette fois pastorale - du troisième et enfin la palpitation bruissante du final nous suspendent dans la microgravité de la délicatesse par la justesse irréprochable des pigments, des enveloppes, du lien et des variations internes de chaque pupitre, chaque individu…
Un possible questionnement que je pourrais réserver pour la rubrique « dynamique » mais qui a sa place ici puisqu’il concerne aussi l’équilibre tonal, apparaît sur divers disques et notamment sur un machin aussi chargé dans le registre grave, voire l’infra, que le début de la BOF de The Dark Knight (oui par Hans Zimmer, à qui il arrive d’être talentueux (ouïe…)) : l’énergie développée est si physiquement bodybuildée dans le disque qu’elle peut « déborder » certaines enceintes et donner l’impression d’une surcharge pondérale se traduisant par une bouillis de loudness.
L’ampli n’y est pour rien !
On a déjà connu le phénomène sur quelques appareils nettement plus puissants et vraiment vraiment rapides et libres dans le bas (l’intégré en 2 blocs mono Apurna, ou les blocs Alef par exemple) qui malmènent tant l’enceinte qu’elle ne suit plus, gavée comme une oie. En usage général, ça ne posera pas de problème majeur, mais sur des enregistrements où la zone basse est à la fois outrageusement pleine ou faite de notes longues ou déliées, ou explorant les tréfonds, incluant quelques musiques électroniques, sort un bourdonnement, certes puissant et qui envoie, mais où on ne distingue plus la moindre variante !
C’est impressionnant quand on se souvient que l’appareil est donné pour 37 W ; afin d’éviter toute méprise, le constat n’a aucun rapport avec le moindre défaut de tenue car, bien au contraire, sur des enceintes goinfres, à bas rendement et haut-parleurs lourds mais qui encaissent bien, on ne note aucun problème de suivi ou de maintien énergétique. Pour tout dire, c’est même étonnant comme le Supremo, en dépit de sa faible puissance revendiquée, est un des amplis qui animent le mieux des haut-parleurs pas super réactifs dans le bas. Ce truc est un cogneur si on lui demande, mais aussi solide que Atlas quand il faut soutenir la sphère céleste. De fait, lorsqu’il accompagne une enceinte réussie à la fois vive et consistante jusque sous les fréquences les plus abyssales, on ne se pose plus la moindre question.
TIMBRES ET ÉQUILIBRE TONAL :
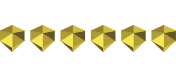
Sans hésiter.
Même si, le jour où on trouve un appareil qui va plus loin encore, les notes ne signifieront plus rien. Que ceux qui n’ont pas lu nos diverses explications comprennent bien que je projette plus souvent des notes de cœur dans l’instant que des évaluations à but de comparaison… En n’oubliant jamais le prix de l’appareil, surtout dans la catégorie de diamant « dorés » qui couvre le panel infini d’appareils au-dessus de 12 000 €.

SCÈNE SONORE
J’ai évoqué Vaughan Williams auprès de qui Ruth Gipps a étudié la composition : pourquoi ne pas s’immerger dans la superbe Symphonie n°7 « Sinfonia antartica » par Sir Andrew Davis dirigeant le Bergen Philharmonic, chez Chandos encore.
La dimension épique de l’œuvre est idéalement mise en scène par Davis qui maîtrise tous les effets, couleurs, élans et souffle héroïque dont la noble phalange est capable, et le spectacle orchestré par le Supremo égale ou dépasse ce que peut donner le cinéma 3D de James Cameron à son apogée. Sir Andrew Davis et le Supremo savent aussi bien illustrer les paysages grandioses, voire grandiloquents, de l’inlandsis lacéré de vents évoquant l’infinitude, que les fragments de lumières, aurores polaires ou fusions des pastels australs ; vocalises du chœur de femmes et du soprano diffusant les rêves de troublantes sirènes, machines à vent qui ramènent à la réalité cruelle dans les mouvements quasi-tectoniques des plaques glaciaires, l’allégresse – incongrue – de la découverte des beautés de la nature dans le « Scherzo » si célèbre, bal euphorique des baleines et pingouins, puis dissolution de l’effroi dans une tension poignante par la monumentale montée orchestre et orgue aux poumons de titans vers un climax atomisant l’inquiétante aube du « 3ème mouvement », avant la dérive, l’« Intermezzo » mélancolique mais apaisé qui suit la mort du Capitaine vers le final d’abord triomphant, un jour nouveau, un regain d’optimisme progressivement teinté d’une tendresse douloureuse, s’évanouissant vers un nocturne impressionniste, hommage à la dimension homérique de l’aventure des pèlerins et leur fin tragique, insufflant la vénusté mystique d’un lent cheminement vers le paradis que méritent ces hommes qui se sont ou ont été sacrifiés à leur passion …
Je me demande parfois si je ne devrais pas reconsidérer la ponctuation de certaines allégories…
Vu que je ne suis pas du genre à craindre les pires transitions, passons d’une œuvre qui parlait d’explorateurs à la Cartography par Arve Henriksen.
Non, je ne suis pas fier de cette vanne-là. Ceci étant, mon mauvais calembour peut revendiquer la nationalité commune entre Carsten Egeberg Borchgrevink, Roald Amundsen et le trompettiste.
L’album date de 2008. J’ai découvert ce musicien dans la voie lactée de David Sylvian qui est d’ailleurs présent sur un titre. Manufacturier de sons - ou plutôt d’atmosphères - tout autant qu’instrumentiste exquis, Arve Henriksen pose de savoureuses perspectives ondulant lentement sous les mélodies longues et minimales de son instrument : croisements comme aléatoires d’improvisations et de parties très écrites, l’album se distingue par une post-production léchée qui ornemente posément des visions filandreuses sans jamais encombrer sa galaxie de fioritures. Les mouvements internes, les jeux de profondeur, hauteur, reliefs ou brumes sont suivis avec une abnégation totale par le Supremo qui nous plonge directement au cœur d’un raffinement oblong dès lors totalement fascinant, contournant l’ennui qui pourrait naître d’une écoute simplifiée.
Sur une succession d’extraits de la suite musicalement hallucinante (ou hallucinée ?) « Pas à Pas / Nulle Part » pour baryton, cordes et percussions de György Kurtág : Signs, Games and Messages - textes de Hölderlin, Beckett et Chamfort (Sébastien) par Kurt Widmer et le Orlando Trio chez ECM – le Supremo campe les intervenants sur une scène d’une ponctualité telle qu’on pourrait en pointer les emplacements sur le sol - qui plus est en détectant avec une totale certitude les dimensions de la salle d’origine -, aussi bien par la minutie prodigieuse de l’interprétation, la délectable captation que par la rigueur d’horloger (suisse ? Après tout la garde pontificale est suisse) de l’intègre italien.
Evidemment, le résultat sera fonction des enceintes, mais l’aération, la présence, la méticulosité de la voix de Widmer ainsi que la précision micrométrique de ses complices, s’expriment dans un épanouissement de couleurs, d’aplomb, d’infaillibilité des matières, frappes cinglantes de bois et peaux, ou murmures précédant le silence d’une vérité et sensibilité qui rapprochent le Supremo de notre référent à tubes.
Un moment aussi saisissant d’autorité, de concentration que de poésie !
En précisant que ce disque voguant du susurrement fervent à la déflagration du tonnerre fait partie de ceux qui peuvent facilement déborder certaines enceintes, point évoqué en rubrique « Timbres ».
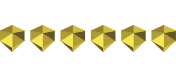
RÉALISME DES DÉTAILS :
La transparence scrute loin dans le cœur des êtres sans jamais être ni artificielle, ni surexposée, ni sujette à la moindre hésitation lors des défouraillages dynamiques :
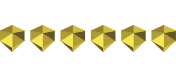
Ah oui, non, zut, c’est pas là qu’il faut donner une note… L’impatience devient une manie…
Un exercice qui pourrait facilement m’être pénible parce que ce n’est vraiment pas ma tasse de thé : Tenebrae Responsoria, œuvre tardive (1611) de Carlo Gesualdo interprétée par l’ensemble Graindelavoix que j’avais découvert à Royaumont (parce qu’on m’avait invité, sinon jamais de la vie !). Performance de la formation flamande évidemment, mais aussi la capacité du Supremo à (permettre d’) isoler chaque individu et ligne vocale au sein de la coterie nous plongent dans un patient recueillement qui, à l’arrivée, est franchement fascinant, évitant le maniérisme souvent pénible dans la musique (et son interprétation) de l’aristocrate de la fin de la Renaissance italienne, marqué au fer rouge de la « légende noire ».
Type d’enregistrement où on n’est jamais à l’abri de la dureté (et il y en a), notamment dans les croisements des voix et réverbérations, le Supremo opère une habile distinction entre la floraison des timbres, la miséricorde profonde des intervenants et les écarts de l’acoustique du site, si subtilement discriminés pour permettre de traverser une expérience spirituelle qui, sur de nombreux autres appareils, me laisserait totalement indifférent.
Ce qui, je l’avoue, devient un problème pour moi : à force de côtoyer l’excellence et savoir la faconde sensible que l’on peut perdre par la banalité de la hifi, je sais parfois passer à côté de certaines œuvres.
Avec le Supremo, aucun risque !
Sans transition :
KMFDM : formation originaire de Hamburg même si à force de changements dans sa composition ne reste guère de teuton que Sascha Konietzko. Et encore, avec un tel nom, on n’est pas à l’abri qu’il soit russe ; bastion - selon certains - du rock industriel allemand, eux ne revendiquent pas l’appellation qu’ils laissent bien volontiers aux vrais fondateurs, les londoniens de Throbbing Gristle (une expérience que je vous ai recommandée dans un précédent article). J’ai voulu tester Paradise, titre pas subtilement du tout ironique et provocateur. Le groupe ne sort guère de ses recettes et s’y révèle clairement moins inventif, plus orienté Metal qu’à l’époque d’Opium (1985), mais l’efficacité est au rendez-vous avec, au milieu des beats aussi légers qu’un Supertanker s’invitant dans un petit port de pêche breton, quelques fugaces scories nouvelles, sonores ou rythmiques, comme dans le morceau éponyme par exemple.
L’énergie constante (et colossale), la pression physique qu’exerce le Supremo, alliées à sa rapidité et ses souplesses d’attaque, extraient paradoxalement des finesses inattendues sous la tendresse du rouleau compresseur et cisèlent quelques stries créatives dans la ruée de bourrin… L’expérience est plutôt ébouriffante… Bon, honnêtement, c’est parce que j’ai voulu voir comment le cénacle germain enragé avait évolué, mais à choisir, écoutez Opium.
Le Supremo sait aussi devenir cristallin, incisif et direct, à preuve l’adaptation (volontairement ?) comique par le Kenichi Tsunoda Big Band, de l’inoubliable thème écrit par Michel Magne pour « Mélodie en sous-sol » dont hélas ce qu’on trouve de la bande originale n’est pas fameux fameux techniquement. Précisément le contraire de la version pulsée par le big Big Band japonais, certes plus massacre que consécration : les miaulements ad hoc des violons, le verbe haut et caustique des cuivres, le lustre des cymbales, la spontanéité de la caisse claire, le tangage boisé de la guitare et de la contrebasse, sont d’une lisibilité absolument parfaite, en dépit d’une scène recomposée en studio ; le Supremo, par sa capacité résolvante d’optique de satellite militaire et son panache de missile, en souligne aussi bien les saveurs composites, l’enthousiasme iconique d’enfants gazouillant à un spectacle de Guignol, que la vacuité artistique, alors que, et c’est rarement le cas dans les disques de jazz audiophile japonais, ces musiciens-là ont un sens « appliqué » du swing, pas exactement naturel mais assurément joueur.
Donc :
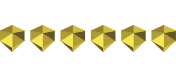
QUALITÉ DU SWING, DE LA VITALITÉ, DE LA DYNAMIQUE
Bon, ben là c’est un festival…
Côté dynamique, l’édifiante évolution du 3ème mouvement de la « Sinfonia antartica » (pourquoi un nom italien au fait ? Déjà pensé à l’époque pour le Supremo ?), racontée plus haut, est poignante d’intensité dramatique ; sous l’intégrale libération d’énergie du Supremo, le climax orchestre et orgue, aussi démesuré que l’inaccessible banquise, suit une progression naturelle, ne décroche ou ne dérive jamais, aucune perte ni d’intelligibilité ni de stabilité de la scène sonore.
Pour voir jusqu’où l’appareil résiste à l’épreuve, un passage par Fanfare for the Common Man (4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba, 3 timbales et 1 tam-tam) dirigé par Louis Lane est une expérimentation aussi réjouissante (ce qui est quand même perturbant quand on se souvient que l’œuvre a été écrite pour l’entrée en guerre des Etats-Unis suite à Pearl Harbor (oui, je suis super balaise pour casser l’ambiance)) que spectaculaire, surtout dans cette version qui a fait talonner plus d’une paire d’enceintes ou saturer bon nombre d’amplificateurs. Eh bien là non. Ça passe à l’aise sans le moindre début de distorsion et avec une aération d’un total naturel, sur les Ava en tout cas, et dans les cas où ça coince un peu, il est clair que ce n’est pas le bolide italien, digne héritier de Ferrari ou Pagani, qui capitule mais les enceintes qui ne supportent pas le punch semblant surgir d’un appareil 5 fois plus herculéen, au bas mot.
La robustesse ressentie est d’ailleurs probablement plus marquée encore que sur les Shinai et Essenza, déjà parmi les intégrés les plus vigoureux qu’on connaisse, pas tant par la capacité dynamique pure que par la sensation d’une sérénité plus grande, d’une force tranquille qui en a toujours sous le pied.
Après le pari insensé co-produit par Boris Wilsdorf que Liesa van der Aa a pris en 2015 en osant le triple album « Woth », un opéra à personnage unique qui arpentait les styles depuis les fondements de la musique jusqu’à sa mutation industrielle avec un talent qu’on pourrait qualifier de génie, impliquant 70 musiciens dans des croisements de genres et d’arrangements passant de chorale au jazz, baroque, variété ou électro, voire, comme je le disais en préambule, rock industriel, où la (jeune) flamande usait à foison de son violon (encore faut-il réussir à reconnaitre un violon tant les abondances en sont métamorphosées), de boucles ou riffs rythmiques d’une solidité de dalle de béton coulée sur les cuves défaillantes de Tchernobyl mais d’une beauté de cathédrale, et de tourbillons épars, légers, périlleux ou effrayants. Elle nous revient (ENFIN) au disque avec un album qui n’a rien à voir : « Easy Alice »
Si typiquement « Woth » est un repère idéal pour spécifier les vertus ou effondrements des appareils, quels qu’ils soient, par l’exigence d’un mixage débordant, pas toujours exempt de duretés dues à l’accumulation sidérante de couches, j’ai quand même choisi le nouvel opus de la prodigue foldingue belge.
Comme « Woth », on peut qualifier « Easy Alice » d’album concept mais c’est vraiment le seul point commun.
Ah non il y en a un autre ! Les deux albums célèbrent pareillement un « maître » étalon qui octroie à la déité créatrice de musiques inimitables, d’univers perturbants, de textes dérangeants atteignant parfois à la métaphysique, l’aptitude à survoler la mêlée depuis des altitudes où elle peut croiser, quoi… une vingtaine d’artistes maximum ?
« Easy Alice » étant un projet complet incluant un « film » et une tournée de spectacle total (avortée évidemment), on aurait pu craindre que la musique ne soit qu’une fraction asservie à un concept global. Non, l’album est un manifeste à lui seul, voire un volcan d’originalités !
Mais autant vous prévenir : le dédale est si entortillé qu’il peut sans doute être épuisant et aussi possiblement inextricable, incompréhension ou réduction qu’une écoute sans un système essentiellement expressif risque de provoquer. Bon, là, évidemment, en compagnie d’un Supremo, on est tranquille. Mais quand même, je doute qu’on entre dans ce chaos en moins de dix écoutes, et encore, en étant totalement disponible.
« Easy Alice », démonstration de la schizophrénie artistique, est un alter ego – au sens de dissociation d’identité - plus impliqué encore que les divers avatars de David Bowie, ajoutant l’ironie d’oser cyniquement une Alice au Pays des Désillusions, revendicatrice, hyperactive, conquérante aux dents longues et égocentrée. La production alambiquée est assise sur des fondations funk d’une basse trapue mais chantante et d’une batterie cinglée en constant déséquilibre, hérissée d’ondes sonores inlassablement réinventées croisant des dialogues absurdes avec des fantômes ressuscités et même des fausses interviews ; en oscillations inépuisables, le groove ne quitte jamais la déstructuration funky bigarrée, le chambardement joueur barguignant de l’ambient à la revendication martelée rock, parfois sur des rythmiques d’une simplicité biblique (pendant 10 secondes) mais d’un mordant qui n’a pas connu d’équivalent depuis la complicité entre Prince et Sheila E (Cynical Brothers).
On ne sait jamais où en est car l’éventuelle stabilité ne dépasse jamais la durée d’une mesure !
On ne sait même plus si l’atmosphère est sombre ou victorieuse, sybarite ou castratrice, mais sous la houle d’un Supremo, on comprend et s’imprègne, ou mieux, on s’enrichit de la cohérence finale à travers le prisme d’un foutoir total, qui pullule du rire à l’apocalypse, où les interstices multiples se propagent à travers des champs quantiques avec la ténacité et la beauté fragile d’une nébuleuse dessinant un édifice en perpétuelle mobilité, dont la géométrie varie selon les caprices de sa Majesté Liesa van der Aa, symbiose émotionnelle qui ose la vérité des contradictions de l’humain, des civilisations, ses beautés, ses mensonges et ses chicanes meurtrières.
Croyez-moi, après s’être pris un machin pareil dans les dents - la schizonévrose comme dopant hallucinogène -, il faut une longue pause pour oser écouter quoi que ce soit, sauf à la rigueur les propos abscons de son aliéniste pour dénouer l’écheveau psychotique…
……………
……………
……………
Ceci était une longue pause.
Après laquelle il faut reprendre l’entraînement avec précaution :
Swing tout en cambrure extatique pour l’anglaise Laura Mvula dans l’album (son deuxième ?) The Dreaming Room, osant une Soul hybride d’influence caribéenne étrangement dévoyée par une ampleur orchestrale hollywoodienne comme support d’extravagance plus que de mégalomanie, pour retourner à des passages batterie, basse, synthé simples à souhait, passer par les riffs de Nile Rodgers ou la légèreté de John Scofield, flottant sur les nuages vaporeux de chœurs dérivants…
L’évanescence de la production, qui semble refuser toute base concrète, aurait pu être un contresens pour la vigueur de bucheron que le Supremo a plaisir à exhiber, mais pas du tout : cette scansion éthérée lui convient parfaitement et mieux que beaucoup il épouse sensuellement le swing blessé qui transparaît sous les plaintes de la londonienne.
Tout le contraire du purement rentre-dedans « Bad Memory » de K.Flay, où l’artiste Hip-hop expérimentatrice manipule dérision, enthousiasme, énervement avec de radicales vertus de ton et de swing. Pas un chef d’œuvre, mais un bon truc bien dansant propulsé comme un uppercut par le bel Italien !
Et puis allez, un petit plaisir coupable : Gainsbourg, « Requiem pour un con », version 1968 pour le film « le Pacha ». C’est une expérience particulière avec le Supremo qui rend justice au foisonnement de swing déroulé par chaque musicien sans la moindre rupture de dandinement exaltant… Bien sûr le détour des touchers des paumes et doigts sur la peau des congas, le tranchant de la caisse claire, mais surtout la teneur affirmée (et non pas rondouillarde) de la basse, et ces fantastiques ricochets rythmiques perceptibles comme jamais entre les piqués de la guitare électrique calés au micron sur le staccato des caisse claire et congas surlignent les singularités du petit bijou…
Ce qui donne envie de comparer à un film dont la musique est aussi célèbre la même année et autant connectée à la rythmique où les bongos répondent aux congas : Bullitt (Lalo Schifrin) et son ambiance groovy / cool très rétro et cependant impérissable, avec la différence flagrante de l’utilisation de la musique au cinéma, quand bien même on note dans les deux cas une mise à l’image de celle-ci : dans le studio d’enregistrement pour le Pacha, et la bossa dans un restaurant pour un dîner amoureux entre McQueen et Jacqueline Bisset dans Bullitt. Etrange concentration musicale qui bizarrement est plutôt dépourvue de swing sur cet instant précis, notamment la flûte virtuose mais peu habitée. On remarquera cependant que jamais la musique dans Bullitt si formidablement arrangée, n’est illustrative ou descriptive, mais remplit des rôles précis, à l’instar des comédiens : définir le temps, c’est-à-dire l’immobiliser, le fausser ou l’allonger, naître en échos de silences taciturnes et définir des atmosphères, un état psychologique, mais jamais une illustration : à preuve la fameuse poursuite automobile bondissant sur les collines de San Francisco où la musique installe une temporalité avant le début de l’affrontement en lui-même, qui dès les premiers patinages de roues laisse place aux rugissements des moteurs, montées en régime, glissades fumant de goudron des pneus et coups de flingues… Par ailleurs, comparable à la musique du Pacha, la peinture de Schifrin (qui n’est même pas sa meilleure) existe en elle-même et franchit le temps pour tourner au classique incontournable.
Si vous avez le privilège de posséder le vinyle d’époque, achetez un Supremo pour vous imbiber de la montée d’adrénaline, de vice ou de beauté directement injectée dans les veines par un ampli destiné à devenir lui aussi un classique.
Est-ce parce que le Supremo ravit tous les sens ? J’ai rarement autant parlé de bande-son dans un banc d’essai…
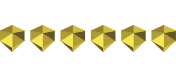
EXPRESSIVITÉ
C’est évidemment le point où un Grandinote creuse l’écart avec la majorité des amplificateurs intégrés (ou pas) à transistors, fussent-ils Classe A, donnée qui ne suffit pas et loin d’en faut. Le Supremo hausse plus loin encore la formidable expressivité de sa famille et tout au plus pourra-t-on regretter le moelleux organique dont quelques référents à tubes ont le secret…
La vibration de l’humain, la présence incoercible des êtres de chair et de sang derrière les instruments ou derrière la pensée, la création, le son comme vecteur de l’âme, tel est le credo du gros intégré transalpin.
Cette vibration habite la parfaite prosodie de Dietrich Fischer-Dieskau (magnifiquement accompagné par Harmut Höll en 1983). Le baryton allemand « vit » « Le Martin-Pêcheur », extrait du recueil de cinq mélodies composées par Ravel sur des textes de Jules Renard, offrant un exemple parfait de ce que le Supremo réussit là où la plupart échoue : respecter le talent inaccessible du Maître du Lied dans la moindre intention jusqu’au subliminal où l’élocution est si parfaite qu’on distingue encore chaque syllabe, pour ne pas dire chaque lettre à l’aube du silence et ce, sans avoir à hausser le niveau pour tricher…
Norma Winstone, déliant suavement « Drifter » est une autre parfaite illustration de cette indéfinissable vibration qui, désincarnée par la hifi, n’est plus que posture… Or, c’est exactement le contraire qui apparaît sous l’empreinte du Supremo : ce qui chez beaucoup d’artistes prétend exprimer un ressenti affectif fondamental basculant souvent, faute de culture ou de distanciation, vers l’affectation est, chez Norma Winstone, voix sensuelle sombre et sensible comme héritée de Jeanne Lee et Helen Merrill, un point de convergence quasi-photographique, un livre expressivement narré par un acteur de haut vol qui ne cherche pas à exister ou briller par son éloquence mais à révéler le mystère des mots aux auditeurs. Après une longue introduction au saxo (Klaus Gesing) et piano (Glauco Venier) en pentes sinueuses et détorses, se faufile la voix merveilleuse de la chanteuse pour susurrer une mélancolie diffuse, en impesanteur d’oiseau de nuit qui par ses orbes délicieuses décrit l’infinie plénitude du chant, de la musique, du texte.
Pour ne pas réduire l’expressivité aux frémissements de la vocalité, je retourne vers l’Indus avec un bon vieux Nine Inch Nails (oui, comme dans un article sur quatre environ je suppose), et le très curieux remix extrait de l’album Y34RZ3R0R3M1X3D, à savoir « The Warning » par Stefan Goodchild et les percussions de Doudou N’diaye Rose. Sur cette piste dont une certaine virilité peut en rebuter plus d’uns, le Supremo souligne toute la verve artistique, le swing complexe de sporanges d’idées éclatant en noyaux énergétiques qui circulent sans effort devant, en dedans, au-dessus et autour de nous, dessinent de longs linéaments aux mouvement furtifs qui se croisent, s’enroulent les uns autour des autres, quadrillent nos sens et nos nerfs, en assurant la cohésion d’un ballet cinétique aux pulsations rythmiques parfaitement réglées. La créativité de Nine Inch Nails via le Supremo ne se mesure qu’à l’aune de nuits passées dans une torpeur fiévreuse en proie à des rêves violents et répétés où les étoiles tourbillonnent dans un ballet incohérent comme des grains de sable sur la peau d’un tambour vibrant.
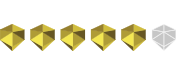
Parce que le moelleux des meilleurs amplis à tubes n’est pas tout à fait là ?
Non, c’est très injuste :
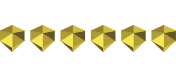
PLAISIR SUBJECTIF
Qu’est-ce qui pourrait manquer ? La puissance pour des enceintes vraiment tordues ?
Alors un conseil : changez d’enceintes !
Pour des pièces très énergivores ? Ah, soit. Pensez au Genesi + blocs Demone… Bon, le budget…
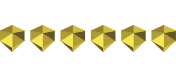
RAPPORT QUALITÉ/PRIX
Le Supremo rejoint et dépasse la famille Grandinote sur les plus hautes marches de notre podium et à cette heure nous ne lui connaissons pas de compétiteurs en intégré à transistors sauf deux (pas forcément intégrés) - peut-être - à prix stratosphériques.
Aucun doute dans notre esprit, le prix a du sens, et est même inespéré.